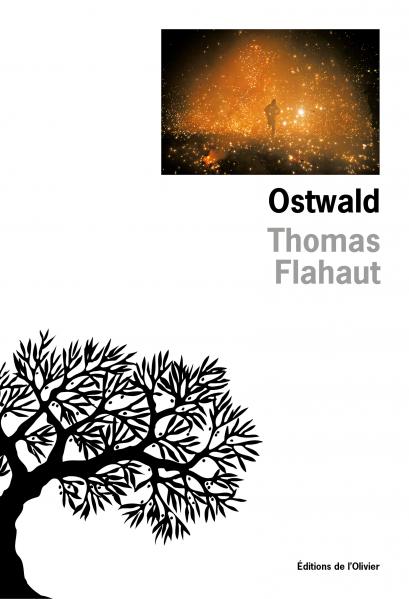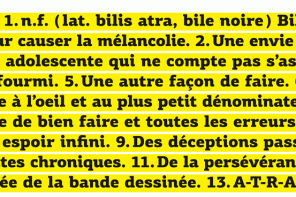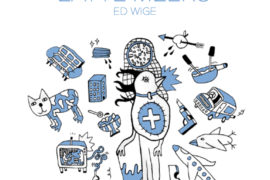Ostwald est un texte tendu qui court entre deux drames. C’est aussi « une tentative de dire combien nous avons déjà les pieds dans la catastrophe », explique Thomas Flahaut, qui a eu l’envie de faire « la version littéraire d’un road movie ». Rencontre avec un auteur sensible aux plaies et aux fleurs du béton.
Quel est le dernier truc qui t’a passionné ?
Un spectacle à l’Arsenic il y a deux semaines : un comédien que j’aime beaucoup, Yves-Noël Genod, lisait et parlait de la Recherche du temps perdu. C’était simple et brillant !
Qu’est-ce que tu lis en ce moment ?
Je lis d’abord les livres des gens avec qui je suis en table ronde, donc là je lis Sangliers d’Aurélien Delsaux, Les Fils conducteurs de Guillaume Poix et aussi Des Châteaux qui brûlent, d’Arno Bertina, un roman choral sur la grève et le mouvement social. C’est trois romans de la rentrée, tous les trois brillants.
Des auteurs phares ?
Je ne sais pas… des textes très différents, que je porte avec moi et que je pourrais relire indéfiniment, parce qu’ils sont tellement grands : il y aurait L’Etabli de Robert Linhart, L’Attrape-cœurs de Salinger et Le Diable au corps de Radiguet. Ce ne sont pas des auteurs totems, mais ils sont importants pour moi.
Quand tu aimes ce que tu lis, tu dévores ou tu savoures, et surtout, est-ce que tu redoutes ?
Ah ! Non, je ne redoute pas : je suis même très content qu’on me laisse sur ma faim, qu’on me dise pas tout, qu’on me lâche comme ça… Un texte comme Le diable au corps, justement, me plonge dans une mélancolie quelques jours et je vis un peu avec ça. J’ai lu un roman de Jakuta Alikavazovic, L’Avancée de la nuit, une histoire d’amour sur fond de guerre civile en ex-Yougoslavie ; c’est aussi un texte qui m’a en quelque sorte déplacé, laissé un peu perdu. C’est quelque chose que j’attends : qu’on me laisse dans un état qui n’était pas le mien au début de la lecture, voire même un état que je ne connais pas.
Quelles actualités te frappent, t’habitent ou t’inspirent ?
« Actualités », je n’aime pas trop ce mot : je préfère le présent, parce que c’est des temporalités un peu plus longues. Ostwald ne répond pas forcément à l’actualité, mais à des craintes qui habitent le présent : la désindustrialisation, la crise migratoire, la violence policière, la violence de l’Etat, entre autres. Ce qui me frappe, c’est le gouffre dans lequel s’abime la France avec le présent gouvernement : on a une espèce de néo-libéralisme extrêmement agressif alors que tout le monde sait, ou devrait savoir, que ça ne fonctionne pas et que ça fait des dégâts énormes. On va petit à petit au chaos en souriant ; c’est difficile à vivre de voir que tout est en train de glisser…
Noël n’envisage qu’avec effroi la vie à venir. Est-ce que cette catastrophe, l‘explosion de la centrale de Fessenheim, représente une chance pour lui ?
Ah mais j’en suis convaincu en vérité ! Je pense que dans le roman, la catastrophe nucléaire est bien sûr une catastrophe écologique et sociale dramatique, puisqu’elle conduit à une explosion de la violence, mais elle rebat aussi les cartes et permet de faire table rase, de revoir notre modèle de civilisation, d’imaginer des nouvelles utopies, une solidarité, un mieux social… Le narrateur passe complètement à côté, mais la fête dans le Parlement, c’est une grande utopie : des jeunes qui dansent sur les ruines du monde.
Dans ce roman familial, le néant révèle en contrepoint la beauté, tantôt douce, tantôt crue, de ce qu’il engloutit. A travers le récit qui se répand comme une onde de choc, les personnages entament une épopée entre l’eau, la lumière, le minéral, les verdures et le béton.
Mon impression générale visuelle du roman, ce serait un grand aplat de gris avec des petites touches de couleurs.
Ouais, comme dans un tableau de Turner : c’est gris, mais il y a un drapeau qui arrive, ou une lumière…
Et il me semble qu’il y a aussi un aspect initiatique dans ce récit, un cheminement intérieur de Noël…
Exactement. J’ai commencé à écrire ce roman, j’avais 21 ans. Là, j’en ai 26, et je sentais que je tenais mon premier roman, quelque chose qui travaille ma sensibilité adolescente en train de s’évanouir. Je voulais capter un peu de ça. Ostwald est une éducation sentimentale, mais c’est aussi une éducation politique. Si tu penses à L’Education sentimentale, le roman initiatique par excellence, le personnage va de déception en déception. Il a beau ne pas s’engager dans les révolutions, il est extrêmement déçu par le coup d’état de 1851, ce dont témoigne ce « il voyagea » de Flaubert… Ecrire un roman initiatique, c’est écrire comment un personnage se prend un mur en pleine gueule. Comment écrire un roman initiatique aujourd’hui ? Ma solution a été de faire péter une centrale nucléaire.
Oui, qui laisse la société éventrée : tout est ouvert. Et un peu plus tard, Noël voit un geste totalement dépassé : quelqu’un ferme sa porte à clé…
Oui exactement ! Il y a des choses qui restent : Noël n’arrive pas à intégrer le changement aussi vite que les autres, je crois. T’es le premier à remarquer ce geste. C’est un passage qui est resté depuis le début. Il y a eu plusieurs gestes de ce type dans des versions beaucoup plus longues ; puis avec les éditions de L’Olivier, j’ai repris totalement le texte.
Rien n’est épargné, mais le lecteur un peu romantique est libre de s’imaginer que quelque chose de neuf va repartir un peu avant la fin ?
La fin n’a pas changé à travers les différentes versions : j’ai toujours eu la certitude que je voulais m’arrêter là, de cette manière assez brutale. Le projet de ce texte, c’est comment le collectif qu’est cette famille réagit à une série de crises ; à la fin, le projet est rempli. La suite serait un autre roman.
Toi, il y a eu un événement qui a recomposé tout dans ta vie ?
Pas vraiment non, si ce n’est l’immigration : en venant en Suisse, j’ai dû réinventer un peu toute ma vie. Mais Ostwald fait plutôt référence à des moments de chaos qui existent, je crois. Pour l’anecdote, j’ai rencontré mon éditeur le 15 juin 2016, au lendemain de la dernière manifestation contre la loi travail, la plus grosse depuis les années 1980 à Paris. C’était la première à laquelle je participais depuis quelques années. Je me suis mis devant, en me disant que c’était plus calme, et en fait la composition des cortèges avait complètement changé : ça chauffait, c’était terrible. On a été gazés dans des impasses, des gens nous ont hissés par les fenêtres dans leurs appartements très chics… Ces moments ne recomposent pas tout, mais ils t’ouvrent des perspectives : c’est vraiment ça qui se passe aujourd’hui. Cette violence, c’est celle de notre temps.

Qu’est-ce que tu ferais à des Félix de ton entourage : envahissants, pénibles ?
Eh bien en fait, j’ai de la sympathie pour Félix. S’il y a un personnage qui ressemble à mes amis, c’est bien lui.
Mais il colonise un par un tous les lits de Noël !
(Rires.) Oui, mais ça, c’est presque humoristique. C’est clair qu’il est envahissant… Mais sa mélancolie et sa déception me touchent beaucoup. Et puis, il a une vraie bienveillance : cette tape qu’il met à Noël comme pour lui dire : « vas-y ! », c’est ce que les amis font pour nous. Félix a beaucoup de vie, je le trouve bien moins lassant que ce narrateur énervant et complètement empêché.
Il y a un peu de L’Etranger dans ce narrateur ?
Oui. Et d’ailleurs, Meursault n’est pas un personnage psychologique : c’est plutôt le programme de l’absurde selon Camus. Félix, lui, c’est un vrai personnage. Comme Marie.
Noël est plutôt à se laisser trainer, mais il va vers certaines personnes. Par exemple, il va, disons, consulter une espèce de saint largué et postmoderne. Il est happé par la vie intense ?
Il y a peut-être une forme de romantisme chez lui.
Oui, parce qu’il suit aussi ce couple d’amoureux…
Oui, mais c’est un peu bizarre aussi ! (Rires)
Complètement, mais ça m’a paru cohérent dans sa bizarrerie ! C’est plus intrigant pour moi qu’il soit attiré par la Gargouille…
Avec le jeune couple, il y a peut-être une forme de fascination esthétique, et puis c’est dans l’ambiance du camp… Pour la Gargouille, j’imagine qu’on a une sympathie particulière pour les vrais marginaux quand on se sent en marge de la société et qu’on n’accepte pas le projet qu’elle conçoit pour nous. C’est un narrateur poétiquement fasciné par la ruine. J’ai l’impression qu’il veut disparaitre, sortir du monde. Ostwald, c’est éventuellement une rêverie, une rêverie sur le déclin, sur la fin du monde… Je voulais prendre un peu le contrepied de ce qu’on nous donne habituellement : plutôt un roman apocalyptique et spectaculaire avec des descriptions tout à fait banales. Je voulais une espèce de poétique de l’Apocalypse : les objets deviennent de plus en plus anciens, la lumière s’éteint, on retourne à une obscurité primitive.
Puis il y a un incendie…
Oui, une espèce de feu de la Saint-Jean. J’ai oublié ta question : je me laissais un peu embarquer comme ça…
Je crois que c’était une question ouverte, un peu sur la Gargouille…
La Gargouille incarne cette rêverie. Je crois qu’on peut le voir autrement aussi : une fois que la société se délite et s’effrite, il ne reste pas rien, puisque ces personnages de marginaux sont peut-être les seuls qui ont des corps, qui existent vraiment. Voilà, je pense, ce que recherche Noël quand il est fasciné par les cheveux roux de Marie : il voudrait qu’elle se taise et qu’elle soit vraiment là, qu’elle arrête de jouer ce jeu de la jeune fille pleine de réussites… Peut-être qu’il veut trouver quelque chose qui ne fuit pas : le présent, un instant. Il ne veut pas être tout le temps dans l’avenir et dans les projets et la catastrophe, c’est au fond ce à quoi il aspire : un absolu présent.
Quel est pour toi le plus grand mur que le narrateur se prend en plein nez ?
Il se le prend à la première page. Voilà la claque ! La catastrophe est là : « ils ont enlevé le ‘h’ de ‘Alsthom’ ». Après ça, on entre dans une écriture extrêmement sèche, le narrateur est désaffecté comme une usine. Noël, c’est un programme poétique : on n’a pas accès à ses sentiments, mais il observe, il se dit par ses souvenirs, ses sensations et ses descriptions.

Oui : les photos dans l’appartement vide, par exemple. Sur une vieille photo, il y a un ciel cyan, je crois, et pouf : tout à coup on a la couleur du ciel !
Ah ouais c’est vrai. Autrement le ciel est noir… et on voit les Vosges ! (Rires.) L’idée, c’était d’avoir une subjectivité désaffectée, c’est ce que je dis dans une interview à Libération.
Avant de conclure, que peux-tu nous dire de tes projets à venir ?
Les 25 et 26 novembre, je serai à Fureur de lire. Je lirai des fragments d’Ostwald accompagné par une guitare électrique, dans un abri anti-atomique. Et le 7 décembre, avec mon collectif Hétérotrophes, qui écrit et fabrique des livres, on fait une soirée au Café Littéraire à Vevey.
Ostwald, c’est un texte sur une société sordide, mais dans un monde qui reste beau ?
Je crois à cette poésie du béton, des aires d’autoroute, des zones d’activités commerciales. C’est le monde d’où je viens. Et puis, le plaisir du roman, c’est aussi de tenter de créer des réseaux de sens et des correspondances, de relier ses sensations à ses réflexions, de construire un monde, de le raconter, de trouver les bons mots pour le dire… C’est le plaisir du mot, le plaisir du récit ou de la phrase. Moi, j’aime la description, et je tends à me tempérer, c’est aussi pour ça que j’ai des personnages avec des histoires, sinon, je décris une place pendant 100 pages…
Eh bien en entrant dans le roman, j’ai été reconnaissant que tu mettes une écriture très belle, ciselée, précise et riche au service d’une histoire, avec des intrigues et des rebondissements, et de pas faire de la littérature pour la littérature…
Je tiens assez à ça : pour moi, il y a quelque chose d’humble dans le fait de ne pas refuser l’histoire. Je crois que notre présent a besoin d’histoires racontées.
Est-ce que le bonheur a germé du chaos ?
Non. (Rires)
Qu’est-ce qui a germé du chaos ?
Le chaos.
Au Festival Fureur de lire
Sa 25 novembre, 11h00 Rencontre avec l’auteur
Librairie Nouvelles pages – rue Saint-Joseph 15 – 1227 Carouge
Di 26 novembre, 11h00 Quitter Pompéi
Lecture post-apocalyptique de Ostwald, avec Antoine Flahaut à la guitare électrique
Abri de la Treille – Place de la Madeleine 1 – 1204 Genève
Avec le collectif Hétérotrophes
Je 7 décembre, 20h30 Lectures
Le Café littéraire – Quai Perdonnet 33 – 1800 Vevey